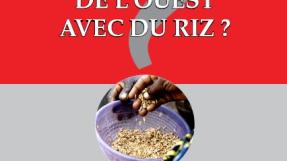Kako Nubukpo : "Un protectionnisme écologique afin de lutter contre les concurrences déloyales"
L’économiste togolais Kako Nubukpo est commissaire à l’Agriculture, aux Ressources en eau et à l’Environnement au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Pour lui, l’Afrique fait face à deux défis concomitants : le défi de la souveraineté agricole et alimentaire en zone rurale, et le défi de l'approvisionnement des zones urbaines alors que les populations, urbaines comme rurales, continuent de croître. Pour relever ces défis en temps de crises, il appelle les Etats à des politiques agricoles plus cohérentes et à changer les règles du commerce international.
Au début de la crise du Covid, vous avez participé à l'appel d'intellectuels africains pour construire l'Afrique d'après et saisir cette opportunité pour sortir des dépendances et des servitudes. Quelle était l'idée principale de cette mobilisation ?
Face au monde qui s'est fermé pendant la crise sanitaire, les Africains ont fait deux constats : le premier, c'est que le cataclysme prédit à l’Afrique par le reste du monde n'a pas eu lieu. Tout d’abord parce que notre population est très jeune, 40 % a moins de quinze ans ! L'Afrique, qui représente quand même 17 % de la population mondiale, n'a eu que 5 % de sa population touchée par la maladie. Donc, elle a proportionnellement mieux résisté à l'épidémie de Covid que le reste du monde. Ce n’est pas neutre pour un continent qui est toujours présenté comme le dernier ! Le deuxième constat est que les représentants des pouvoirs publics africains, qui ont tendance à venir se soigner dans les hôpitaux du Nord chaque fois qu'ils ont un souci, se sont rendu compte qu’ils avaient tout intérêt à développer des systèmes de santé résilients dans leurs propres pays. Nécessité faisant loi, la réflexion est allée dans le sens de développer soi-même les facteurs de résilience ! Donc la petite agriculture périurbaine, la santé, la scolarisation, la nutrition…
Nous nous sommes saisis de ces événements dramatiques pour appeler à un sursaut des pouvoirs publics et des populations d'Afrique pour dire que le développement est d'abord et avant tout un processus endogène. Ce qu'on avait eu tendance à oublier. On avait l'impression que le reste du monde pensait pour l'Afrique. Et cette pandémie a été au fond une sorte de réveil brutal dont on pouvait tirer quelque chose de positif.
Y a-t-il une prise de conscience des décideurs pour défendre une vraie souveraineté alimentaire ?
Depuis les indépendances, on a fait du « biais urbain » en Afrique de l’Ouest : on a privilégié l'approvisionnement à bas coût des villes et on a abandonné les paysanneries. Aujourd'hui, à la faveur des crises sécuritaires et climatiques, on se rend bien compte que cela ne fonctionne pas. On a l’exemple du président de l'Union Africaine, Macky Sall, qui est allé rencontrer le président Poutine pour obtenir des engrais chimiques. Face au risque d’émeutes de la faim, la vision politique est toujours à court terme. Mais il est important de se demander ce que l’on peut apprendre de ces crises à répétition. Surtout pour le moyen terme. C'est là qu’il y a toute la réflexion autour de la souveraineté agricole et alimentaire. Toutefois, l'articulation du court terme et du moyen terme nécessite de savoir gérer les transitions !
Pour les organisations paysannes, l'insécurité alimentaire est structurelle, ce qui veut dire que les États portent cette responsabilité d'insécurité alimentaire. Êtes-vous d’accord ?
C’est complexe. Concernant la souveraineté alimentaire, nous avons vécu trois phases : la première a été celle des indépendances, avec le leitmotiv qui était celui de « l'autosuffisance alimentaire », donc des États jeunes, indépendants, se sont lancés dans beaucoup d'investissements agricoles pour obtenir l'autosuffisance alimentaire, avec certaines dérives gestionnaires.
Ces dérives ont d'ailleurs conduit à la deuxième phase, celle des ajustements structurels, où le mot d'ordre fut « la sécurité alimentaire » suite au rapport Berg de la Banque mondiale. Le contrat de l’époque stipulait : « Vous n'êtes plus obligés de produire ce que vous consommez, si vous avez suffisamment d'exportations, et vous récupérerez des devises pour importer votre alimentation. » Mais au moment de la crise alimentaire de 2008, la Banque mondiale a fait son autocritique en disant : « Effectivement, nous sommes allés trop loin. Vous pouvez produire ce que vous consommez. »
En fait, la crise russo-ukrainienne vient amplifier une tendance en cours depuis une dizaine d'années, qui consiste à dire « l'Afrique devrait produire ce qu'elle consomme ». Mais cela pose la question de la comptabilité des différentes politiques publiques.
La déclaration de Maputo de 2003 indique que chaque État devait consacrer au moins 10 % de son budget à l'agriculture. Mais le contenu des 10 % fait encore débat : est-ce qu'on y met le machinisme agricole, les investissements ? D'un État à l'autre, la comptabilité des 10 % ne sera pas la même ! Au Togo par exemple, nous avons longtemps eu autour de 4 % du budget consacré à l’agriculture, mais si vous mettez de grands investissements dans le budget, vous allez rapidement atteindre 10, 15, 20 %, alors que peu d’argent va concrètement aux paysans.
Tout le monde est conscient de l'urgence des enjeux, mais on n’arrive pas à gérer les priorités. C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Au-delà de la mauvaise foi de certains dirigeants, beaucoup de difficultés sont liées à la gouvernance pour piloter ces défis. C'est un point très important.
[...]
Cet article est extrait de la publication L'espoir au-delà des crises, solutions ouest-africaines pour des systèmes alimentaires durables, 3ème tome d'une série d'ouvrages collectifs édités par le programme Pafao.